 Décidément, je n’ai pas de chance avec les journalistes depuis quelque temps. J’avais eu une première mésaventure qui m’avait permis de forger le Ratio de Canard, puis une deuxième mésaventure avec une lettre de ma part pour bien recouper le poil du Canard avant qu’il ne se rétracte. Au début de cet après-midi (vendredi), un journaliste m’appelle au sujet de la BPI. J’étais en plein dans la rédaction d’un de mes propres articles, aussi nous convenons de nous rappeler à 16h30. Mais – et c’est là où je commence à avoir la puce à l’oreille – il me pose tout de même quelques questions à la va-vite. Je lui fais des réponses tout aussi à la va-vite, et lui dis qu’on se parlera plus aisément à 16h30 – tout en me demandant s’il rappellera effectivement, ou bien s’il estimera avoir tout glné en 5mn.
Décidément, je n’ai pas de chance avec les journalistes depuis quelque temps. J’avais eu une première mésaventure qui m’avait permis de forger le Ratio de Canard, puis une deuxième mésaventure avec une lettre de ma part pour bien recouper le poil du Canard avant qu’il ne se rétracte. Au début de cet après-midi (vendredi), un journaliste m’appelle au sujet de la BPI. J’étais en plein dans la rédaction d’un de mes propres articles, aussi nous convenons de nous rappeler à 16h30. Mais – et c’est là où je commence à avoir la puce à l’oreille – il me pose tout de même quelques questions à la va-vite. Je lui fais des réponses tout aussi à la va-vite, et lui dis qu’on se parlera plus aisément à 16h30 – tout en me demandant s’il rappellera effectivement, ou bien s’il estimera avoir tout glné en 5mn.
16h29, je me suis rasé, je suis à côté du téléphone.
18h49, je me sers un verre, il n’appellera plus.
Aussi, fidèle à mon habitude, et tant qu’à avoir planché un minimum sur le sujet, je livre mes deux centimes de réflexion sur le sujet de la BPI (Banque Publique d’Investissement).
Je me sers – fort commodément – des questions de ce dit journaliste pour orienter cette synthèse.
Question : La BPI pour financer les entreprises françaises, est-ce une structure adaptée ou inadaptée ?
(Veuillez noter la demande journalistique, qui veut toujours qu’on réponde par Blanc ou Noir. Mais nouzautres, les professeurs-chercheurs, nous suivons toujours l’exemple de notre maître à penser, Jean-Jacques Goldman, et son bel album Entre gris clair et gris foncé).
Ma réponse : en tant que telle, la BPI n’est que la fusion de plusieurs entités qui faisaient déjà ce travail = Oséo et CDC Entreprises, avec une saupoudrée de FSI par-dessus. Aussi, quant à se prononcer sur l’adaptation de cette fusion… Je me permets d’être un peu dubitatif. On se souvient d’une autre fusion : ANPE et Assedic, qui a donné lieu à un « guichet unique » appelé Pôle Emploi. Plusieurs mois après, on constatait que le guichet unique avait du mal à masquer deux systèmes qui, ma foi, n’avaient pas l’air d’avoir fusionné.
Ce n’est pas en déclarant une fusion, et en recrutant / formant à la va-vite des petits jeunes (ou moins jeunes) qu’on crée de l’efficience. L’efficience, ça ne passe pas obligatoirement par la case pognon, mais il faut reconnaître que ça aide. En bref, une entité unique sans financement conséquent, c’est aussi amusant que de dire qu’en collant le corps d’un lézard à la carcasse d’un pigeon, on obtiendra un dragon qui vole.
Question : À propos des pigeons, il y a une controverse : ce gouvernement taxe plus lourdement les entrepreneurs (et ceux-ci roucoulent de colère sur Facebook) et la BPI arriverait pour aider ces mêmes entrepreneurs, n’est-ce pas paradoxal ?
La question est très (trop) simpliste.
Ce que l’on peut retenir de la colère des entrepreneurs (mouvement des pigeons) tient à mon avis en trois choses : ils s’indignent de l’alourdissement de la taxation des plus-values lors de la cession de leur entreprise ; ils grognent contre la hausse des charges sociales qui leur est imposée ; ils s’énervent contre des amalgames à vrai dire assez malheureux (entrepreneurs = riches ; entrepreneurs = patrons profiteurs).
Je ne vois là-dedans pas grand chose que la BPI pourrait contrebalancer, il n’y a pas vraiment de « paradoxe » (mais le journaliste aime bien cette notion de paradoxe : créer le paradoxe, c’est augmenter la valeur de l’analyse qui va suivre). Je vais donc essayer de lier deux phénomènes qui à mon avis ne sont pas clairement liés.
1. Rappelons le principal problème des entrepreneurs : trouver de l’argent qui leur permette de survivre suffisamment longtemps pour arriver à la profitabilité. La plupart – si ce n’est la totalité – des entrepreneurs que je rencontre ou que je conseille sont certes animés par la foi inébranlable de leur idée, mais ils sont confrontés à un problème dramatique : leur idée prend du temps à décoller, et nécessite des fonds de démarrage souvent très importants. Quelles sont les solutions ?
- Investir leurs propres deniers ou faire appel au Love money, l’argent de leurs proches. Ça dure un temps, d’autant que la majorité des entrepreneurs ne viennent pas de la famille Kennedy-Onassis.
- Faire appel aux Business Angels : ceux-ci, entrepreneurs qui ont réussi, réallouent leur argent dans d’autres projets. Ils ont des qualités (ils savent ce qu’est l’entrepreneuriat, ils ont de l’expérience à transmettre) mais aussi des défauts inhérents au contexte : ils sont peu nombreux, et comme tout être humain, sensibles aux conditions légales et fiscales dans lesquelles ils s’engagent. Or, sur 10 sociétés financées par un business angel, peut-être une seule sera un vrai succès. Cela signifie que le succès de cette société doit non seulement rémunérer le capital qui a été engagé dedans, mais aussi compenser la perte du capital dans les 9 autres. C’est là où on voit que la variable fiscale (taxation de la plus-value à la fin) peut modifier cet équilibre subtil qu’on appelle le couple risque-rentabilité : si la rentabilité finale baisse et ne compense plus les risques pris, les business angels ne financent plus (autant) les startups. Mais l’ampleur du phénomène est à ma connaissance difficilement mesurable : qu’il y ait moins de business angels, peut-être ; mais que ce soit dû essentiellement à cette réforme fiscale, on n’en sait rien. À mon avis, les business angels qui quittent la France le font pour des raisons autrement plus structurelles et profondes – voire morales – que la récente annonce sur la taxation des plus-values à la sortie. Donc analyse simpliste.
- Faire appel aux banquiers. Hahahaha. Passons vite. Ce n’est pas le métier du banquier, qui prête de l’argent temporairement en échange de garanties solides de paiement de l’intérêt et du remboursement du capital. Toutes chose qu’un entrepreneur, malgré son feu sacré, ne peut garantir tangiblement. Donc les banquiers ne financent pas les startups, point.
- Il reste donc l’aide publique. Cela mérite une analyse un peu détaillée, parce que cette aide publique recouvre différentes choses.
2. L’aide publique de la BPI (ou ce que j’en comprends aujourd’hui, et les questions qui en découlent)
La bonne chose est que la BPI n’aura pas autant une exigence de rentabilité, voire de sécurité : si elle suit un objectif de politique publique, elle peut avoir pour ligne directrice de « financer en limitant les pertes », alors qu’un acteur privé « finance en cherchant une rémunération correcte ». Cela laisse évidemment plus de latitude, et permet de financer plus d’entreprises (pas seulement les plus mirobolantes, aidons les jeunes). Maintenant, balayons rapidement les différents types d’aides, juste pour souligner leurs différences :
- Des subventions. Remboursables à la fin ou non, le plus souvent sans intérêt, ce sont des prêts gratuits, voire des dons (si non remboursables), même si la fiscalité des subventions resterait à assouplir (une subvention donnée par l’État est souvent considérée comme un revenu, qui est donc taxé et qui renvoie l’impôt à l’État – avec en plus les problèmes de trésorerie inhérents : le moment où l’on touche la subvention n’est pas le même que le moment où l’on doit régler l’impôt. On peut faire plus simple, non ?)
- Des prêts. La BPI se susbtitue alors aux banquiers, avec un objet social (pour une fois, ce terme porte bien son nom) différent. C’est intéressant, dans la mesure où cela fait intervenir dans le financement des startups un élément qui est souvent chroniquement absent (cf. ci-dessus) : les dettes financières. Et l’intérêt d’une dette, c’est qu’elle est temporaire dans le financement. Une fois remboursée (c’est-à-dire, une fois qu’on commence à gagner plus d’argent qu’on en dépense), l’entrepreneur reste seul au contrôle de sa société, la banque (ici la BPI) ayant aidé à « faire la soudure », parfois pendant plusieurs années. C’est une vraie aide au développement des sociétés.
- Des apports en capitaux propres. Plus rares (et je ne sais pas quelle en sera l’étendue dans la future BPI), les apports en capitaux propres consistent à se présenter comme un « Business angel public », qui investit dans la société en échange de parts. La BPI devient alors actionnaire des startups. Et ce qui pourrait être poilant, c’est qu’en temps qu’actionnaire, elle sera soumise à la même taxation sur la plus-value en cas de revente de la société. Entrepreneurs et BPI vont alors souffrir en même temps de cette réforme fiscale. Cela reste néanmoins à approfondir : rien ne dit qu’il n’y aura pas un mécanisme de derrière les fagots pour dire « ah ouais mais en fait les apports de la BPI ne sont pas assujettis à la taxation sur la plus-value ». Les décisions politiques sont presque aussi volatiles que la Bourse, c’est dire.
En conclusion sur ce point, et c’est une idée importante : la création d’une BPI n’apporte rien de nouveau. Toutes ces missions, tous ces financements sont déjà mis en place soit chez Oséo, soit chez CDC Entreprises, soit dans le FSI. La création d’une BPI « chapeautant » (à mon avis, c’est ce qu’elle fera, je n’écris donc pas « intégrant ») ces organismes pré-existants ne peut apporter une contribution qu’à certaines conditions que je liste ci-dessous.
3. Les points de vigilance sur la création et le développement des actions de la BPI
Je vois 3,5 points majeurs de vigilance pour juger du bien fondé de la création de cette entité : les missions, les moyens, la gouvernance (et un demi-point : les synergies).
(a) Les synergies (valeur au barême : 1/2 point)
On peut arguer qu’en intégrant ou fusionnant Oséo / FSI / CDC entreprises, on va faire des économies et on va améliorer la qualité des interventions (ce qu’on appelle les synergies d’une fusion). Mais l’histoire des entreprises nous montre que les fusions sont coûteuses en frais d’intégration, et que les projections futures sur-estiment régulièrement les économies, alors qu’elles sous-estiment dramatiquement les coûts marginaux de fusion. À ce jour, rien ne permet d’affirmer qu’une BPI unique sera plus efficace ou moins coûteuse que les 3 entités précédemment mentionnées. Il faut ajouter à cela des frais de superstructure, des conseils d’administrations supplémentaires, bref, toute une bureaucratie. Or l’ajout de bureaucratie a rarement été synonyme d’efficience (c’est un euphémisme).
(b) les missions
Dans une économie où l’on nous rebat les oreilles de mots comme austérité, réduction du déficit public, économies sur les dépenses publiques, j’aimerais bien que la mission de la BPI soit clairement affirmée – et tenue au fil du temps – par exemple sous la forme « la mission de la BPI n’est pas de faire fructifier l’argent de l’État, mais bien d’encourager et développer la création d’entreprises innovantes, de les soutenir tant qu’elles ne sont pas arrivées à la profitabilité, puis de se retirer grcieusement en se réjouissant du développement du tissu économique et de la création d’emplois pérennes ».
(c) Les moyens
Si la création de la BPI ne s’accompagne pas d’une levée de capitaux supplémentaires, alors il n’y aura aucune ressource additionnelle générée par cette fusion, alors qu’il y aura forcément des coûts additionnels. Et donc, sans dotation de fonds supplémentaires conséquents, la création de cette BPI sera juste celle d’une grosse verrue supplémentaire dans le système fonctionnel français. Il reste donc à voir si la BPI sera dotée de fonds additionnels, et dans quelle proportion, et avec quelles missions (cf. point (b) ).
(d) La gouvernance
Une des questions majeures dans une politique industrielle est celle de sa stabilité dans le temps. De même qu’il faut parfois plus d’un siècle pour qu’une politique de natalité donne des résultats pérennes, une politique industrielle à 10 ou 20 ans ne peut pas se détricoter au rythme des mandats électoraux. Cela nécessite une indépendance par rapport au pouvoir politique. Cette indépendance doit reposer sur des mécanismes de gouvernance ( = de contrôle raisonnablement indépendant) et de transparence : le contribuable intéressé et motivé doit pouvoir retracer l’utlisation des fonds et leur adéquation avec la mission publique, de même qu’un donateur à une oeuvre d’utilité publique se voit communiquer régulièrement un détail de l’utilisation des dons qui ont été faits. Certes, cela fait un peu « boy scout idéaliste » de penser qu’on peut empêcher totalement les conflits d’intérêts. Mais il serait bon pour le moral des contribuables (qui votent) de leur rendre régulièrement des comptes. C’est probablement ce qui fait la différence entre une démocratie et une république bananière : la transparence. Et je le répèterai toujours : la garantie d’une démocratie, c’est ausi le travail d’un bon journalisme d’investigation, avec des enquêtes en profondeur qui dépassent les synthèses de comptoir de bar.
Ce qui nous ramène à ce journaliste dont je n’ai pas retenu le nom. Il m’a appelé en tout début d’après-midi, et nous nous sommes fixé un RV à 16h30. Entre-temps, son site a publié un article… sur la BPI, tiens donc. A-t-il jugé que ce que j’avais dit en 2 mn suffisait ? Est-ce une pure coïncidence (un collègue publiant aussi sur la BPI à 13h07, soit après son coup de téléphone, et lui ne rappelant pas à 16h30, les deux événements étant bien sûr totalement indépendants ?) Nous ne le saurons probablement jamais, et ça ne va pas nous empêcher de dormir – mais j’aimerais tout de même qu’on s’excuse quand on me pose un lapin.
Le côté positif, c’est que j’ai pris le temps d’organiser mes pensées, et que vous y avez gagné une synthèse de mes réflexions sur la BPI. En espérant qu’elle vous aie intéressé(e)s.


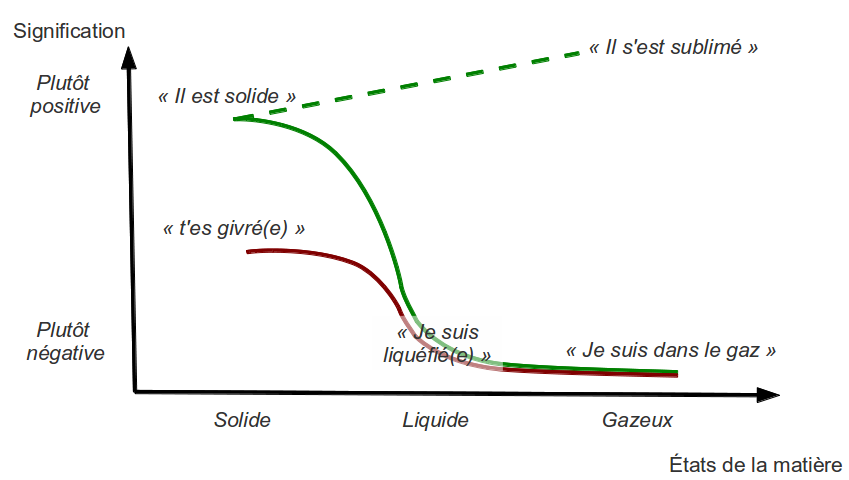



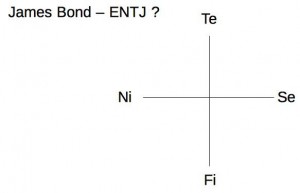
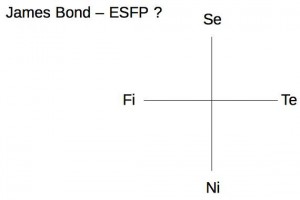


 Décidément, je n’ai pas de chance avec les journalistes depuis quelque temps.
Décidément, je n’ai pas de chance avec les journalistes depuis quelque temps. 