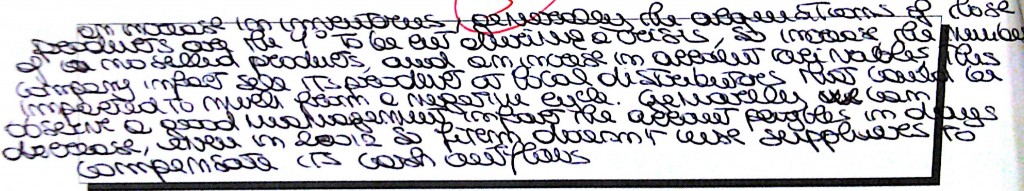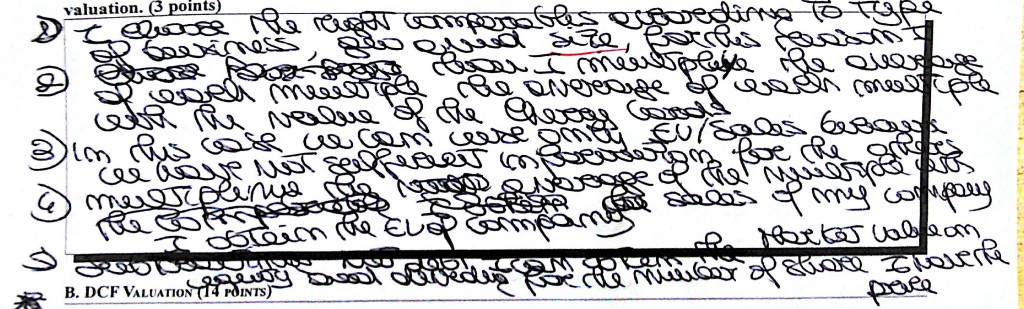(Ce thibillet est le 3ème d’une série de 4 qui m’ont été inspirés par les événements tragiques de la semaine du 11 janvier – je ne l’ai pas posté à l’époque et hélas, il est plus que jamais d’actualité)
Derrière la question un peu simpliste du titre, il y a une interrogation personnelle : pourquoi les attentats des 15 dernières années se réclament-ils tous, ou quasiment tous, d’un Islam radical ? Pourquoi n’y a-t-il pas des terroristes se réclamant d’un christianisme intégriste, ou des juifs terroristes commettant et revendiquant leurs actes au nom (de leur vision) de la religion juive ? En cherchant, je suis sûr qu’on pourra trouver des exemples, mais la question demeure : pourquoi l’islam est la religion – et la raison invoquée – de la majorité des terroristes ?
On peut incriminer la religion, ou des facteurs extérieurs à la religion. Allons-y ensemble.
Est-ce que les écrits de l’islam sont plus violents – ou incitent à plus de violence – que la Bible ou le Talmud* ?
Il ne me semble pas. Chaque religion, dans son livre, a des passages qui incitent à la violence, et d’autres passages qui incitent à la paix. Pour la Bible, par exemple, on peut voir une distinction entre l’ancien testament, où Dieu apparaît souvent comme un dieu de colère, et le nouveau testament, où Jésus prône un message d’amour. Or, l’interprétation qui est faite des textes varie suivant les époques. Par exemple, à une certaine époque, l’église catholique, avec sa mission évangélisatrice et son Inquisition, a conduit à des massacres, voire des génocides, tout cela au nom d’une certaine interprétation des textes. La question devient alors : qu’est-ce qui fait qu’un texte immuable (si l’on met de côté le problème des traductions, ce qui est aussi une vraie question) peut être interprété différemment suivant les époques ?
Prenons un exemple qui m’est familier : le prêt d’argent avec intérêt. Dans la Bible, il est interdit de pratiquer un taux d’intérêt, et c’est mentionné au moins 3 fois (Ezechiel 18:8, Lévitique 22:25, Deutéronome 23:19 et suivant, et on en retrouve des mentions dans le nouveau testament). Mais l’interprétation qui en est faite depuis plusieurs siècles permet à tout chrétien de pratiquer le taux d’intérêt. De même, dans le Talmud, le prêt à intérêt est interdit à au moins 3 endroits (Chémot 22, Vayikra 25, Dévarim 23). Or, depuis des siècles, les juifs se prêtent à intérêt, même entre coreligionnaires. Sur ce thème, le Coran donne la même consigne (ne pas prêter à intérêt, 2ème sourate, verset 275), mais elle s’illustre par une pratique beaucoup plus stricte : l’interdiction de prêter à intérêt est réellement appliquée, à tel point qu’a été créée une finance islamique, c’est-à-dire une finance particulière qui tient compte de ces contraintes des textes sacrés. En résumé grossier, les 3 textes sacrés donnent la même injonction, mais les 3 religions n’appliquent pas cette injonction de la même manière aujourd’hui.
Venons-en à la violence.
Les écrits religieux, quels qu’ils soient, alternent les recommandations à la paix, et les exhortations à la violence. La première question est simple : le Coran est-il plus violent que les deux autres livres sacrés ? À ma connaissance, la réponse est non. L’ancien testament ou encore la bible hébraïque contiennent quantité d’exhortations à la violence, et si l’on raisonne en terme de « quantité », le Coran n’a pas « plus » d’écrits incitant à la violence que les autres livres. Mais il peut être intéressant d’adopter une approche chronologique. L’ancien testament, ou la bible hébraïque, sont le fruit de siècles de création et de transmission, tandis que le Coran en tant que livre* s’étend sur la fin de la vie du prophète, soit un peu plus de 20 ans. Il y a donc un temps de production long pour les bibles, et beaucoup plus raccourci pour le Coran. Néanmoins, dans les deux cas, les exégètes reconnaissent une évolution dans les textes. Les textes les plus anciens de la tradition chrétienne et juive sont plus violents, les textes les plus récents dans la chronologie sont plus modérés. Dans le Coran, c’est l’inverse : les sourates de Médine (celles de la fin de la vie du prophète) sont plus dures vis-à-vis des infidèles que les sourates de la Mecque (début de la révélation par Mahomet).
L’évolution de la violence dans les textes sacrés, quelques idées
Chez les chrétiens et les juifs, le fort étalement dans le temps des écrits permet de présupposer que les textes se sont peu à peu adaptés à des conditions de sociétés qui changeaient. L’ancien testament aurait été rédigé entre le VIIIème siècle et le IIème siècle avant JC, soit une période de 6 siècles ! Et encore, on parle ici de rédaction, on peut supposer qu’il y a eu une production et une transmission orale auparavant… sur combien de temps ? Aussi, aux premiers temps de la production des textes, on peut imaginer des contraintes qui se sont peu à peu allégées, et qui ont été remplacées par d’autres contraintes au fil du temps.
Par exemple, dans les premiers temps, il s’agit d’imposer un seul dieu, là où les traditions reconnaissaient et pratiquaient des dieux. Donc, pourquoi pas un dieu terrifiant, qui impose sa loi et punit les incroyants.
Il y a aussi, aux premiers temps, des questions de survie : survie du groupe en tant que groupe (lois, traditions, interdits, culture et mythes fondateurs), et survie face à d’autres groupes (esclavage, guerres, mais aussi culture dominante vs. culture minoritaire). Les textes anciens reflètent probablement ces priorités. Puis, quand la religion commence à être établie, les problèmes deviennent autres, ils se déplacent, et les textes plus récents traitent de cette évolution. Ça ne me semble donc pas aberrant de voir que la violence des premiers textes (quand il s’agit de survie, non seulement de la religion en tant que telle, mais aussi des pratiquants de cette religion) évolue, dans les textes produits des siècles après, en des considérations plus pragmatiques, et plus modérées : il ne s’agit plus d’imposer une religion, mais de vivre harmonieusement au sein d’une religion. Et par exemple dans la religion chrétienne, Jésus est un grand modérateur : il prône l’amour du prochain, il condamne la lapidation, bref, il « réécrit » les textes anciens avec une nouvelle interprétation, non seulement plus modérée, mais aussi, semble-t-il, plus adaptée aux conditions temporelles du moment (le nouveau testament dans sa production écrite date du Ier siècle après JC, soit 2-3 siècles après la fin de la production de l’ancien testament).
Qu’en est-il du Coran ? Étalé sur une période de production plus limitée, il est révélé et transmis par Mahomet sur une période d’une vingtaine d’années, au VIIème siècle, et sa transcription écrite / sa compilation datent de ce même siècle. Si l’on adopte ici aussi une approche chronologique, on distingue les sourates de la Mecque (avant l’Hégire, donc avant que Mahomet ne devienne un chef politique) et les sourates de Médine (après l’Hégire). Les sourates de la première catégorie sont (j’utilise mes propres mots) plus religieuses, inspirationnelles, synthétiques sur cette religion. Dans l’expression « l’esprit et la lettre », on serait plutôt du côté de « l’esprit ». Les sourates de la seconde partie sont plutôt pragmatiques, précisées, codifiées. On serait plutôt du côté de « la lettre ».
Cette distinction entre les deux périodes, reconnue par les exégètes, conduit à des questionnements de la part des fidèles : quand on constate des contradictions apparentes entre différents textes du Coran (y compris dans leur interprétation), si l’on doit choisir, doit-on se conformer plus à l’esprit ou à la lettre ? La question n’est visiblement pas tranchée clairement, ou en tout cas, pas aussi clairement que dans les autres religions, qui ont l’avantage (si je puis dire) du temps extrêmement long qui sépare les premiers textes des derniers. En résumé, ma perception :
– tous les textes sacrés parlent de violence
– dans les textes chrétiens et hébraïques, cette violence est plutôt cantonée aux temps anciens, et les écrits récents montrent un adoucissement, très probablement issu de l’évolution des sociétés.
– pour le Coran, le texte sacré est séparé en deux périodes historiques distinctes : quand le prophète n’était pas encore un leader politique (et où il parle moins de violence) et quand il est devenu un leader politique.
– Ainsi, suivant que l’on adhérera plutôt aux premières sourates, ou aux dernières, le Coran prendra des valeurs différentes. Et compte-tenu du fait que l’ensemble des sourates est ramassé sur un temps très court, il est compréhensible que des croyants optent pour une orientation, ou l’autre… ou prennent le Coran dans son ensemble.
En conclusion, ce qui me semble important à préciser – tout ça pour ça, me direz-vous – c’est de se rendre compte que derrière ces interprétations de la violence des textes sacrés, il y a, dans le cas du Coran, tout un rapport avec le rôle politique de la religion. C’est à partir du moment où Mahomet devient leader politique que les textes montrent une inflexion plus marquée vers la violence. Et qu’on ne fasse pas dans le simplisme. Je ne suis pas en train de dire que la politique amène la violence. Je veux juste dire que dans ces 3 religions, l’Islam m’apparaît comme la seule qui, dès sa construction, contienne une dimension politique de la religion.
Note :
* Pour chaque livre sacré, je prends des raccourcis de langage. On sait que chaque livre sacré est un corpus composé de texte écrit, de texte oral, de jurisprudences ou d’épitres. Pour les juifs, quand je parle de Talmud, je parle en fait de l’ensemble des livres sacrés juifs : d’une part la bible hébraïque qui contient notamment la Torah, d’autre part le Talmud, mais aussi la jurisprudence rabbinique – halakha. Pour les musulmans, quand je parle du Coran, je parle aussi de la Sunna, des hadiths et de la charia. Pour les chrétiens, quand je parle de la Bible, il s’agit de l’ancien et du nouveau testament – en toute rigueur, je devrais aller jusqu’aux bulles pontificales et papales. Cela dit, force est de constater que tous mes exemples viennent essentiellement des textes sacrés fondateurs : bible hébraïque, ancien testament, nouveau testament, coran.